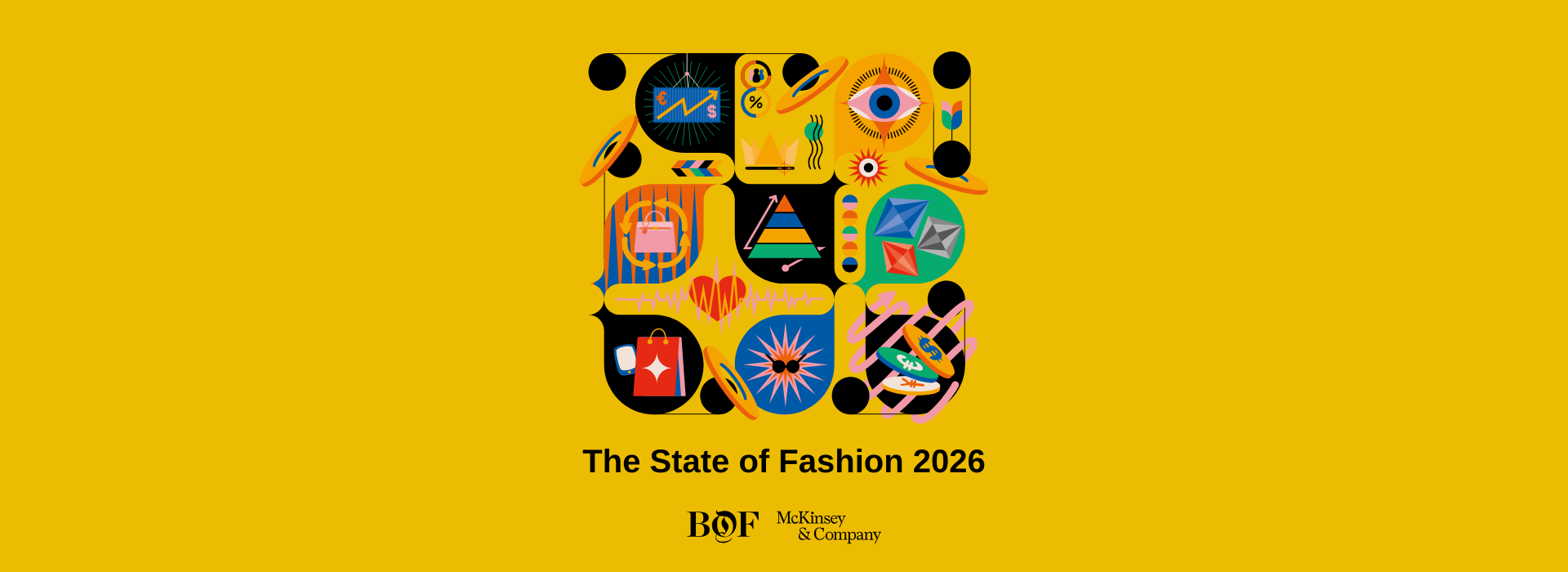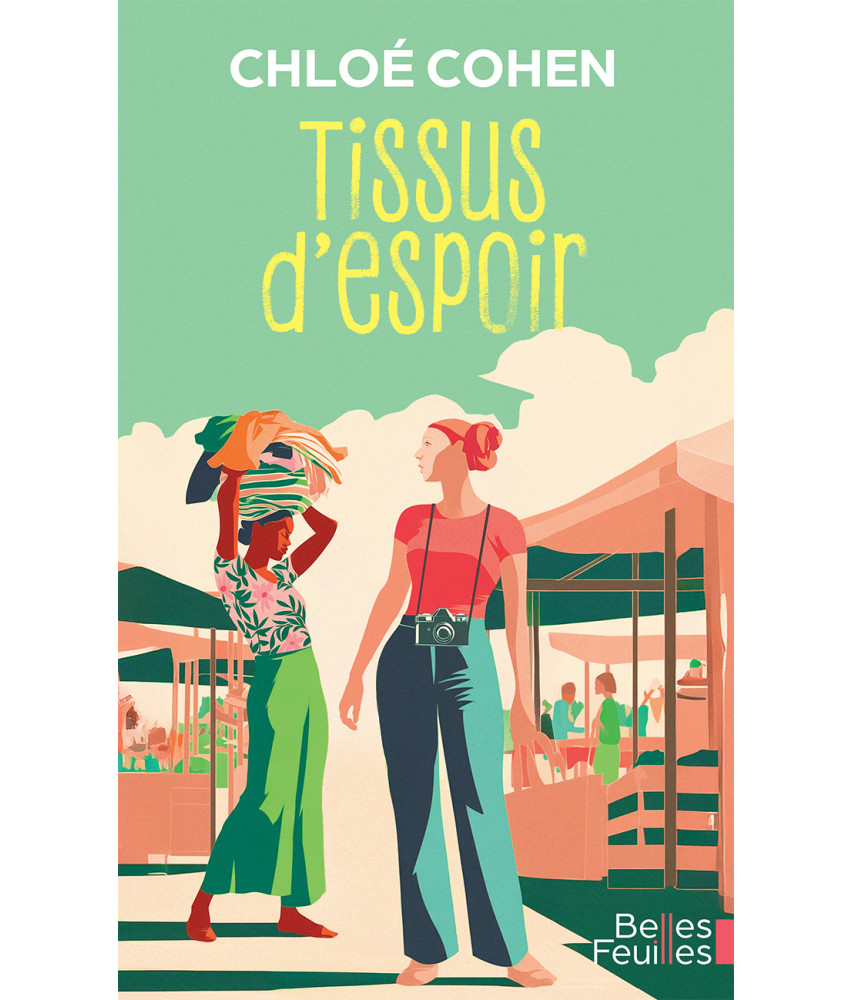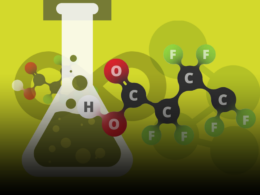Réputée pour son podcast Nouveau Modèle, pionnier sur l’impact de la mode, la journaliste Chloé Cohen publie son premier roman : Tissus d’espoir. L’une de ses protagonistes est une porteuse du marché de Kantamanto, au Ghana. Une intrigue largement inspirée du monde réel : le travail de ces femmes, qui transportent chaque jours des dizaines de kilos de déchets textiles venus d’Europe, est l’un des plus difficiles de l’industrie de la mode. La journaliste espère ainsi continuer à alerter sur la surproduction et ses conséquences, notamment pour les femmes. Entretien.
Vous avez longtemps animé le podcast Nouveau Modèle. Pourquoi êtes-vous passée à un autre format pour parler de l’impact de la mode ?
Chloé Cohen: Premièrement, j’ai une formation avant tout littéraire avec le journalisme et je voulais revenir à l’écriture. Deuxièmement, j’ai animé Nouveau Modèle pendant cinq ans et j’ai l’impression d’avoir couvert ces sujets au maximum via ce format. Je voulais éviter de tomber dans la redondance, toucher de nouveaux publics de façon différente. La fiction est un moyen de faire passer des messages engagés, qui peuvent être mieux reçus qu’avec de l’information pure et dure. Au travers des personnages notamment, nous sommes touchés. Alors j’ai parlé de la mode avec un roman. Sans avoir l’ambition de « révolutionner les mentalités », mais pour ouvrir des discussions, des interrogations et peut-être encourager les gens à regarder leurs vêtements différemment.
Commander « Tissus d’espoir »
Le contexte qui guide votre intrigue est celui des porteuses du marché de Kantamanto, au Ghana. Pourquoi avoir choisi de relater leur vécu ?
Chloé Cohen: J’ai choisi ce sujet car il m’a énormément marquée lorsque je l’ai découvert. Avant Nouveau Modèle, j’étais déjà plus ou moins informée sur l’exploitation dans les ateliers, les violences que vivaient les femmes, les enfants… Mais je n’avais jamais entendu parler de cette problématique-là. Alors que c’est un sujet énorme qui dépend directement de l’Europe ! On surproduit des vêtements que nous n’avons pas la capacité de traiter, dont la qualité baisse de plus en plus, puis on s’en débarrasse dans des pays qui n’ont rien demandé. C’est lunaire. Il n’y a pas que le Ghana bien sûr, mais ils doivent se charger d’un énorme afflux de vêtements (NDLR : le marché de Kantamanto reçoit des millions de pièces par semaine). Les porteuses doivent transporter des balles de plus de 50 kilos sur leur tête, à travers les allées très étroites du marché. C’est un travail difficile, qui cause de nombreux problèmes de santé, mais aussi précaire. Elles sont donc vulnérables à tous types de violences. Ce sont souvent des jeunes femmes, voire des enfants.
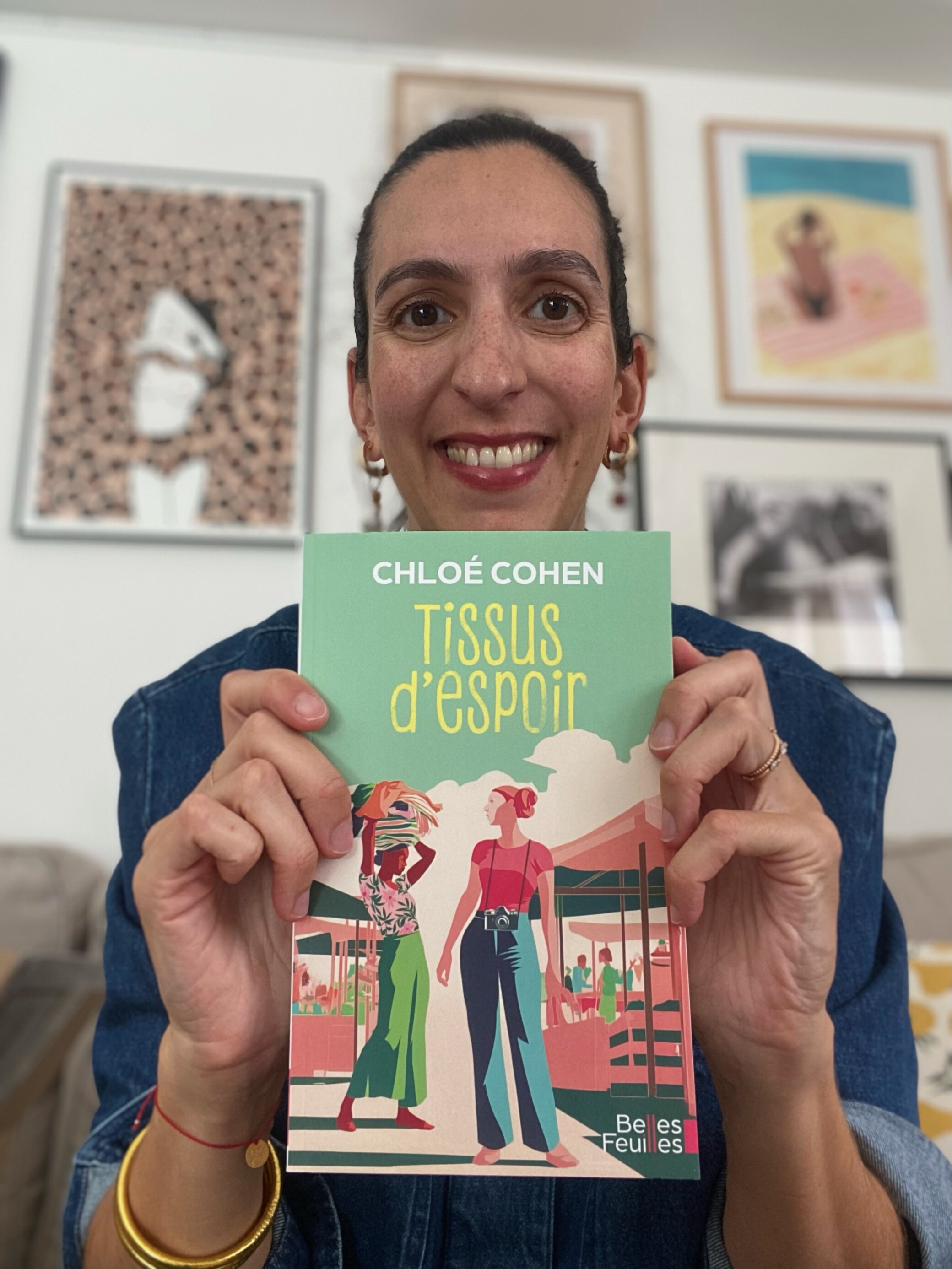
Justement, l’un des enjeux de Tissus d’espoir est la création d’un syndicat de porteuses qui se battent pour améliorer leur situation.
Chloé Cohen: Pour la précision, la création d’un syndicat dans ce contexte précis est fictionnelle. Mais c’est essentiel : en créant des groupes, on a toujours plus de poids de revendication que lorsqu’on est isolé·e. La force du collectif permet de faire entendre des voix qui peuvent être étouffées autrement. Notamment dans la chaîne de production textile ! L’idée m’est venue d’un film basé sur une histoire vraie : Made in Bangladesh. J’avais interviewé sa réalisatrice Rubaiyat Hossain pour un épisode du podcast, qui relate l’histoire d’une femme exploitée pour des vêtements et qui décide de créer un syndicat féminin. Je trouvais le symbole de ce regroupement de femmes, de cette sororité, très fort.
La sororité et le féminisme sont d’ailleurs des thématiques centrales de votre roman. Selon ce que vous avez observé dans votre carrière, en quoi les conditions de production de la mode sont-elles reliées au féminisme ?
Chloé Cohen: L’industrie de la mode est largement féminine, notamment dans la production*. Les ouvrières, celles qui permettent l’existence du vêtement, sont des femmes aux conditions précaires. Alors que les postes décisionnaires, la direction artistique ou la gestion d’ateliers sont majoritairement occupés par des hommes. En ce sens, la mode expose de façon très cliché le fonctionnement du patriarcat, où les hommes décident et les femmes exécutent. De plus, les mauvaises conditions de travail favorisent les violences patriarcales : agressions sexuelles, viols, exploitation économique, absence de couverture sociale, charge de la famille en plus du travail… D’où l’importance d’organisations pour de meilleures conditions.
Commander « Tissus d’espoir »
« Le contexte est morose pour les entreprises engagées, elles méritent d’être mieux accompagnées. » Chloé Cohen, autrice de Tissus d’Espoir
Dans votre roman, vous évoquez une association qui soutient les porteuses de Kantamanto. Ce n’est pas sans rappeler le travail de la OR Foundation, très impliquée dans le marché.
Chloé Cohen: L’association dépeinte dans le livre et ses membres sont totalement inventées, mais la fondation OR a bien sûr été une inspiration. J’ai interviewé une de leurs chargée de plaidoyer, Clémence Faure, et ce qu’elle avait raconté m’avait bouleversée.
La cause majeure qui déclenche les problématiques de Tissus d’espoir est la surproduction de la mode. D’après ce que vous avez pu observer lors de votre carrière, l’industrie prend-elle cet enjeu suffisamment au sérieux ?
Chloé Cohen: Clairement, non. C’est le problème qu’on ne veut pas voir, il dérange. Je comprends les problématiques économiques des marques, mais on est dans une dérive totale. On veut toujours plus. Chez la fast et ultra fast fashion, mais aussi de façon générale. Il faut une volonté politique pour endiguer cela, mais aussi pour soutenir les marques éthiques ! Celles qui proposent de la location, de la seconde main, qui sont raisonnées, circulaires… Le contexte est morose pour les entreprises engagées, elles méritent d’être mieux accompagnées.
Commander « Tissus d’espoir »
La soirée de lancement de Tissus d’espoir aura lieu le 2 octobre à la boutique 17h10, 36 rue de Sévigné, 75003
* Environ 80% des travailleur·euses textiles sont des femmes (Clean Clothes Campaign)