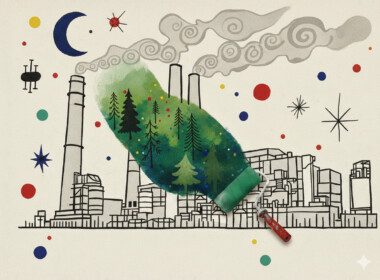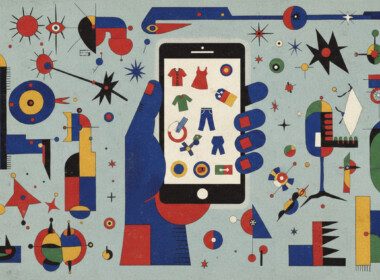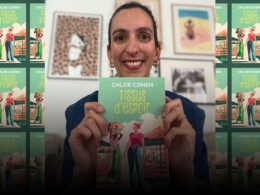Le 30 juillet 2025, l’ONG ActionAid France révèle un rapport d’enquête. Au cœur du système de production ultra-réactif de SHEIN, un maillage discret mais essentiel structure l’offre textile chinoise : les villages urbains de Guangzhou. Ces territoires hybrides, à la croisée de l’habitat précaire et de l’atelier clandestin, sont devenus en deux décennies la matrice silencieuse d’une fast fashion mondialisée. Pour réaliser cette enquête sous couverture, des chercheuses du China Labor Watch se sont fait embaucher dans des ateliers produisant pour SHEIN à Kangle, afin de documenter directement les conditions de travail sur place. Elles ont pu recueillir une cinquantaine de témoignages, à l’intérieur et à l’extérieur des ateliers. Une partie des témoignages provient d’ancien·nes employé·e·s. Les ateliers ne produisent pas exclusivement pour SHEIN et ne sont ni contractuellement liés à la marque ni officiellement identifiés par celle- ci comme fournisseurs directs. Ils interviennent ponctuellement, comme le démontre notre enquête, souvent lors de période de forte demande, comme des sous-traitants de seconde main mobilisés par les fournisseurs agréés. [Note du rapport d’enquête]. Au-delà de l’illustration concrète de la représentation que nous avons des usines de SHEIN, ce rapport révèle la gravité, la persistance et l’impunité des mensonges proférés par la marque qui nie en bloc les allégations concernant l’exploitation humaine sur ses chaînes de valeur ou se défend de prendre au sérieux les éventuels manquements et de les corriger dès que ceux-ci sont portés à leur connaissance. Toute l’industrie, en France et à l’international, doit s’évertuer à interrompre définitivement l’activité de l’ultra fast fashion, à faire respecter les Droits Humains les plus fondamentaux et appliquer une concurrence loyale.
Un précédent rapport de Public Eye en 2021 alertait déjà sur les conditions de travail chez les fournisseurs de SHEIN. En 2025, les mêmes violations persistent, preuve que les engagements RSE de la marque sont inefficaces ou purement cosmétiques.
LIRE AUSSI Notre dossier sur la situation des Ouïghour·es en Chine SHEIN, maître du green et social washing Comprendre SHEIN pour faire réguler la marque
Les villages urbains, artefacts de la croissance urbaine chinoise

Les villages urbains (城中村, chengzhongcun) sont une spécificité du paysage urbain chinois. Nés du développement accéléré de villes comme Guangzhou, ils résultent d’une urbanisation mal planifiée qui a absorbé, sans les démolir ni les restructurer, des hameaux ruraux intégrés à la trame métropolitaine. Ces villages, souvent laissés à l’écart des programmes d'aménagement public, se sont transformés en zones de non-droit fonctionnelles : des enclaves densément peuplées, abritant des millions de travailleur·euses migrant·es venus de provinces rurales (Hubei, Jiangxi, Fujian) en quête d’opportunités économiques. En 2025, Guangzhou compte 139 villages urbains, chacun spécialisé dans un secteur industriel. Le plus emblématique d’entre eux : Kangle, au sud-est de la ville, centre névralgique de la confection textile ultra-rapide.

Le village de Kangle, l’usine textile du monde bâtie sur un monceau de précarité
Sur à peine un kilomètre carré, plus de 100 000 personnes vivent et travaillent à Kangle, dans un enchevêtrement d’immeubles vétustes, de ruelles sombres, de fils électriques pendants, de cuisines de rue et d’ateliers clandestins. C’est ici que la fast fashion prend forme, à une cadence qui défie la norme, le commerce international loyal et les Droits de l’Homme. Ces bâtiments, surnommés « bâtiments poignée de main », sont si proches les uns des autres que les voisins pourraient s’échanger des objets à travers leurs fenêtres. Dans ces structures souvent non déclarées, le logement se confond avec l’espace de production : machines à coudre, cartons d’emballage, piles de tissus, enfants, ouvrières et vaisselle cohabitent dans une promiscuité extrême.

Une logistique chaotique, une production industrielle qui reste artisanale, totalement décentralisée
Le système repose sur une chaîne de sous-traitance éclatée et volatile : SHEIN passe commande à des ateliers de taille moyenne, qui eux-mêmes externalisent à des micro-ateliers, souvent tenus par un·e ancien·ne ouvrier·ère devenu·e chef·fe de cellule de production. Ces ateliers informels, sans existence légale, s'arrachent les commandes à la tâche et ajustent la production à la demande du jour. Ce maillage décentralisé, réactif et ultra-flexible, est précisément ce qui rend possible la promesse de SHEIN : produire en 7 à 10 jours entre la création du design et la mise en ligne sur la plateforme. Les délais sont tenus au prix de journées de travail allant jusqu’à 15 heures, 6 à 7 jours sur 7, sans contrat, ni protection sociale. Un témoignage recueilli dans le rapport indique que certaines ouvrières doivent assembler plus de 300 pièces par jour pour atteindre un revenu décent : environ 500 € mensuels à Guangzhou. Les rémunérations oscillent entre 0,06 € et 0,27 € par pièce, selon la complexité du vêtement. Aucune heure supplémentaire n’est payée. Chaque minute d’inactivité devient une perte de revenu.

Recrutement sauvage, précarité systémique
Le recrutement dans les villages urbains se fait de manière directe, physique et numérique. Des marchés de l’emploi improvisés, sur les trottoirs ou dans les ruelles, permettent aux travailleur·euses de signaler leur disponibilité à l’aide de pancartes. En ligne, des offres circulent dans des groupes de discussion sur WeChat, souvent réduites à quelques mots : “Couture, logement inclus, 0,5 yuan/pièce”.
Abonnez-vous au média
Accédez à l’ensemble de nos articles et ressources.
The Good One
Assurez votre veille continue et montez en compétences.
Essayez gratuitement pendant 7 jours
- Accédez à tous nos articles
Entreprise
Inspirez et nourrissez l’intelligence de vos équipes.
- Accédez à tous nos articles et contenus
- Décryptez les enjeux systémiques et découvrez les solutions clés pour le secteur
- Tarifs préférentiels sur nos partenariats média
Pour nous contacter : morning@thegoodgoods.fr
The Good One
Votre veille annuelle en toute sérénité.
Économisez 60 € par rapport a un abonnement mensuel.
- Accédez à tous nos articles toute l’année
Entreprise
Offrez à vos équipes un accès complet.
- Accédez à tous nos articles et contenus
- Décryptez les enjeux systémiques et découvrez les solutions clés pour le secteur
- Tarifs préférentiels sur nos partenariats média
Pour nous contacter : morning@thegoodgoods.fr
*Abonnement renouvelable par tacite reconduction